Emplois et stages dans les métiers de l'eau
Toutes les offres d'emplois et de stages dans les métiers de l'eau, mises à jour quotidiennement
Trier les annonces :
Diffuser une offre d'emploi ou de stage
Recevoir les nouvelles annonces par
Email
Twitter
RSS
CVthèque, déposez votre CV sur le site
Ajouter mon CV Consulter la base de CV
110 offres disponibles

Technicien instrumentation des cours d'eau (H/F)
EPTB Maralpin - Syndicat Mixte pour les Inondations, l'Aménagement et la Gestion de l'Eau (SMIAGE)Date limite : 01/02/2026 (publiée le 04/12/2025)

Chargé d'exploitation spécialité hydraulique et DECI (H/F)
Annemasse AgglomérationDate limite : 04/01/2026 (publiée le 04/12/2025)

Assistant pour la mise en place d’un suivi de contaminants chimiques sur des zones à forts enjeux H/F
SurfriderDate limite : 19/12/2025 (publiée le 04/12/2025)

Analyses de données Phénomènes de ruissellement
DDT de la Haute-GaronneDate limite : 04/01/2026 (publiée le 04/12/2025)
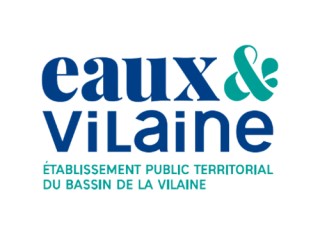
Technicien(ne) agricole aménagement de bassin versant
EPTB VilaineDate limite : 04/01/2026 (publiée le 03/12/2025)

DERU2 et gestion du temps de pluie H/F
Agence de l'eau Seine-NormandieDate limite : 03/01/2026 (publiée le 03/12/2025)

Stage hydrologie des zones humides : croiser les problématiques locales aux connaissances scientifiques
Forum des Marais AtlantiquesDate limite : 12/12/2025 (publiée le 03/12/2025)

Technicien(ne) conduite d'opérations travaux eau et assainissement (H/F)
CA Grand ChambéryDate limite : 06/01/2026 (publiée le 02/12/2025)

Chargé(e) de mission PEP Ehn-Andlau-Scheer
Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA)Date limite : 02/01/2026 (publiée le 02/12/2025)

Stage M1 Dynamique saisonnière d’un continuum fleuve intermittent / estuaire temporairement fermé
Université de CorseDate limite : 31/01/2026 (publiée le 02/12/2025)

Diagnostic / plan d'actions sur un périmètre protection de captage
CC Lamballe Terre et MerDate limite : 14/12/2025 (publiée le 02/12/2025)
Veille eau c'est aussi

UN AGENDA DES ÉVÈNEMENTS
Tous les évènements à venir dans le monde de l'eau

Appui à la conception et à la mise en œuvre de la politique de sobriété hydrique des acteurs du sport
Ministère de l'Education nationale et de la JeunesseDate limite : 02/01/2026 (publiée le 02/12/2025)

Stage master pro réactualisation PDPG (H/F)
FDAAPPMA 04Date limite : 15/01/2026 (publiée le 02/12/2025)

Contamination du bassin Seine-Normandie par les pesticides H/F
Agence de l'eau Seine-NormandieDate limite : 27/12/2025 (publiée le 01/12/2025)

Suivi et Mise en Œuvre du Plan d’Action de Lutte contre les Eaux Claires Parasites F/H
Métropole Aix Marseille Provence (MAMP)Date limite : 17/12/2025 (publiée le 01/12/2025)

Modélisation réseau AEP et autosurveillance réglementaire du système d’assainissement F/H
Métropole Aix Marseille Provence (MAMP)Date limite : 17/12/2025 (publiée le 01/12/2025)

Plans de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE) F/H
Métropole Aix Marseille Provence (MAMP)Date limite : 17/12/2025 (publiée le 01/12/2025)

Stage PAPI Val de Saône et côte viticole : charte eau et hydraulique douce (H/F)
EPTB Saône et DoubsDate limite : 31/12/2025 (publiée le 01/12/2025)

Étude pour la valorisation écologique des plans d'eau du territoire de la Métropole Rouen Normandie
Syndicat mixte de gestion de la Seine normande (SMGSN)Date limite : 31/12/2025 (publiée le 01/12/2025)

Stage état des lieux des enjeux piscicoles sur le territoire du sage camargue gardoise (H/F)
Syndicat Mixte pour la protection et la gestion de la Camargue GardoiseDate limite : 15/12/2025 (publiée le 01/12/2025)

Collecte et analyse de données techniques relatives à la collecte et au traitement des eaux usées urbaines en vue du rapportage européen concernant la directive relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (DERU)
Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN)Date limite : 01/01/2026 (publiée le 01/12/2025)

Technicien d’instruction des eaux pluviales urbaines (F/H)
CA Grand AnnecyDate limite : 29/12/2025 (publiée le 30/11/2025)

Directeur des régies eau et assainissement (H/F)
Syndicat Intercommunal d'Aménagement de Rivières et du Cycle de l’Eau (SIARCE)Date limite : 30/12/2025 (publiée le 30/11/2025)

Technicien(ne) Assainissement / Eau potable et Hydraulique Urbaine H/F
CeregDate limite : 30/12/2025 (publiée le 30/11/2025)
Veille eau c'est aussi

DES PUBLICATIONS
Plus de 2 100 publications classées par thématique

Chef(fe) de projet Maîtrise d'oeuvre assainissement
Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA)Date limite : 30/12/2025 (publiée le 30/11/2025)

Stage dynamique des populations de poisson de bourgogne-franche-comté (H/F)
Office Français de la Biodiversité (OFB)Date limite : 19/12/2025 (publiée le 30/11/2025)

Évolution des écosystèmes aquatiques continentaux sous l’effet du changement climatique
InraeDate limite : 20/12/2025 (publiée le 30/11/2025)

Appui aux missions de prélèvement, de mesure et d'analyses quantitatives et qualitatives sur rivière et nappe au sein du laboratoire d'hydrobiologie et analyse de l'évolution de l'Indice Poissons Rivière au sein du Bassin Versant
Syndicat Intercommunal d'Aménagement de Rivières et du Cycle de l’Eau (SIARCE)Date limite : 30/12/2025 (publiée le 30/11/2025)
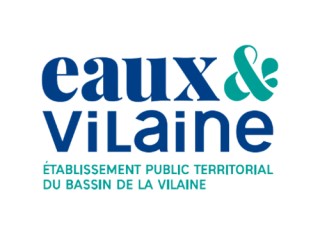
Responsable de l'Unité de Gestion Vilaine Aval
EPTB VilaineDate limite : 28/12/2025 (publiée le 27/11/2025)

Ingénieur expert responsable études et modélisation hydrauliques assainissement et eaux pluviales (F/H)
Grenoble-Alpes MétropoleDate limite : 04/01/2026 (publiée le 27/11/2025)

Stage Ingenieur Charge d'Etudes Hydraulique H/F
Société du canal de Provence (SCP)Date limite : 27/12/2025 (publiée le 27/11/2025)

Stage animation du PDPG (plan de gestion départemental) H/F
FDAAPPMA 26Date limite : 19/12/2025 (publiée le 27/11/2025)

Responsable unité travaux GEMAPI (F/H)
Grenoble-Alpes MétropoleDate limite : 25/12/2025 (publiée le 26/11/2025)

Technicien assainissement (F/H)
Syndicat Durance LuberonDate limite : 26/12/2025 (publiée le 26/11/2025)

Evaluation socio-économique des projets de protection contre les inondations
AberlazDate limite : 26/12/2025 (publiée le 26/11/2025)

Technicien Projet Ouvrages Hydrauliques - Modélisation 3D (F/H)
BRLDate limite : 26/12/2025 (publiée le 26/11/2025)

Responsable du pôle Assistance technique à l'exploitation en eau et assainissement (H/F)
Conseil départemental de la DrômeDate limite : 04/01/2026 (publiée le 26/11/2025)
Veille eau c'est aussi

UN ANNUAIRE DES BUREAUX D'ETUDES
Bureaux d'études dans les métiers de l'eau, classés par département

Hydraulique urbaine et assainissement : anticiper les impacts du changement climatique sur les réseaux d’eau (F/H/NG)
SCEDate limite : 26/12/2025 (publiée le 26/11/2025)

Suivi des populations de Lamproie marine (Petromyzon marinus) sur la Somme et ses affluents et caractérisation des habitats migrateurs
FDAAPPMA 80Date limite : 05/01/2026 (publiée le 26/11/2025)

Suivi de l'anguille européenne et des poissons migrateurs dans le marais poitevin
PNR du Marais PoitevinDate limite : 14/12/2025 (publiée le 26/11/2025)

Description et analyse des peuplements piscicoles des cours d’eau (H/F)
PNR MorvanDate limite : 26/12/2025 (publiée le 26/11/2025)

Ingénieur(e) chef(fe) de projet renaturation des milieux aquatiques et humides
Syndicat Intercommunal d'Aménagement de Rivières et du Cycle de l’Eau (SIARCE)Date limite : 25/12/2025 (publiée le 25/11/2025)

Chargé(e) de production et de maintenance
CA Grand ChambéryDate limite : 04/01/2026 (publiée le 25/11/2025)

Mise en place d'un superviseur des ouvrages de suivi des eaux souterraines et analyse critique des données quantitatives du réseau départemental du Vaucluse
Conseil départemental du VaucluseDate limite : 25/12/2025 (publiée le 25/11/2025)

Stage Ingénieur en hydraulique fluviale H/F
HydrétudesDate limite : 25/12/2025 (publiée le 25/11/2025)

Chargé de mission métrologie - modélisation réseau d'eau potable H/F
Orléans MétropoleDate limite : 25/12/2025 (publiée le 25/11/2025)

Stage sur les PFAS sur le bassin Seine-Normandie H/F
Agence de l'eau Seine-NormandieDate limite : 25/12/2025 (publiée le 25/11/2025)

Chef de projets expérimenté en hydraulique fluviale H/F
HydrétudesDate limite : 24/12/2025 (publiée le 24/11/2025)

Elaboration d’une méthode d’inventaire et analyse des données des mollusques bivalves (H/F)
FDAAPPMA 16Date limite : 02/01/2026 (publiée le 24/11/2025)
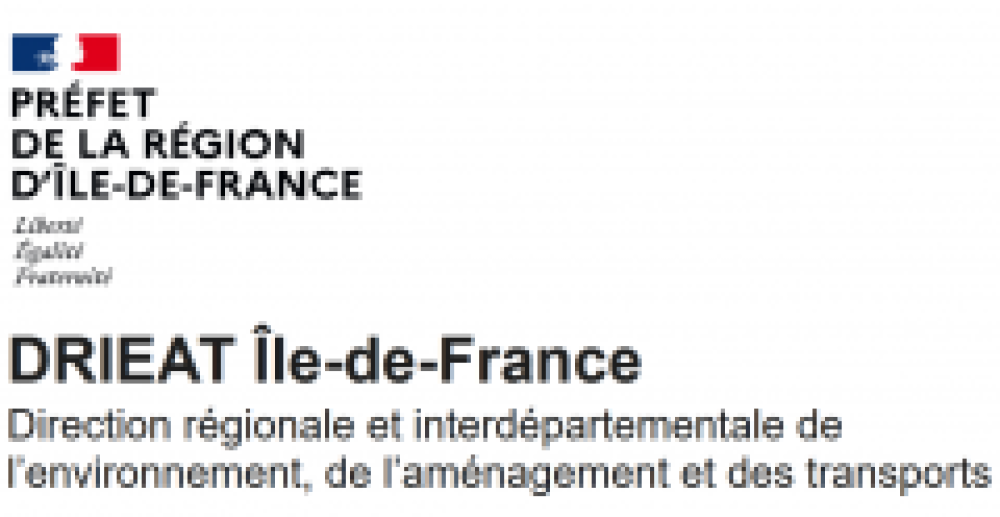
Création d’un outil d’analyse de prévision quantitatives des crues sur le territoire du service de prévision des crues Seine Moyenne Yonne Loing
DRIEAT Île-de-FranceDate limite : 24/12/2025 (publiée le 24/11/2025)

Chef(fe) de pôle exploitation eau potable (H/F)
Annemasse AgglomérationDate limite : 20/12/2025 (publiée le 20/11/2025)

Stage master modélisation hydrodynamique du fossé de Sierentz (H/F)
ApronaDate limite : 20/12/2025 (publiée le 20/11/2025)
Veille eau c'est aussi

UN AGENDA DES ÉVÈNEMENTS
Tous les évènements à venir dans le monde de l'eau

Stage ralentissement du cycle de l'eau en forêt publique (H/F)
Syndicat Mixte du Bassin de l’Authion et de ses Affluents (SMBAA)Date limite : 15/12/2025 (publiée le 20/11/2025)

Chargé d'études Données sur la ressource en eau (H/F)
Agence de l'eau Artois-PicardieDate limite : 20/12/2025 (publiée le 20/11/2025)

Optimisation du réseau de suivi piscicole
FDAAPPMA 51Date limite : 09/01/2026 (publiée le 20/11/2025)

Etude et synthèse de données pour la rédaction d’un diagnostic écologique d’un cours d’eau salmonicole : La Vezouze amont
FDAAPPMA 54Date limite : 20/01/2026 (publiée le 20/11/2025)

Chargé(e) de projets eau dans la ville
Conseil départemental de Seine-Saint-DenisDate limite : 20/12/2025 (publiée le 20/11/2025)

Chargé(e) d'opérations PGSSE/GSP/AMO - Service Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (SAMO)
Charente EauxDate limite : 12/12/2025 (publiée le 19/11/2025)

Politique départementale de gestion et de valorisation des cours d'eau landais
Conseil départemental des LandesDate limite : 12/01/2026 (publiée le 19/11/2025)

Analyse de la pollution au TFA et aux PFAS sur le bassin versant des Gardons
EPTB GardonsDate limite : 08/12/2025 (publiée le 19/11/2025)

Stage - Appui à l’élaboration du plan de gestion du marais du Pas de l’Estang
Syndicat Mixte du bassin du Roubion et du Jabron (SMBJR)Date limite : 31/12/2025 (publiée le 19/11/2025)

Exploitant du réseau d’eau potable (F/H)
Angers Loire MétropoleDate limite : 11/12/2025 (publiée le 19/11/2025)

Stage - Participation aux suivis piscicoles et à l’analyse des données du compartiment poisson (F/H/NG)
SCEDate limite : 19/12/2025 (publiée le 19/11/2025)

Impact des ruissellements sur la vie aquatique : installation de 6 turbidimètres en rivière et exploitation des données
FDAAPPMA 76Date limite : 16/01/2026 (publiée le 19/11/2025)

Chargé(e) d'opération Digues plateforme d'Angers
EPTB LoireDate limite : 17/12/2025 (publiée le 18/11/2025)
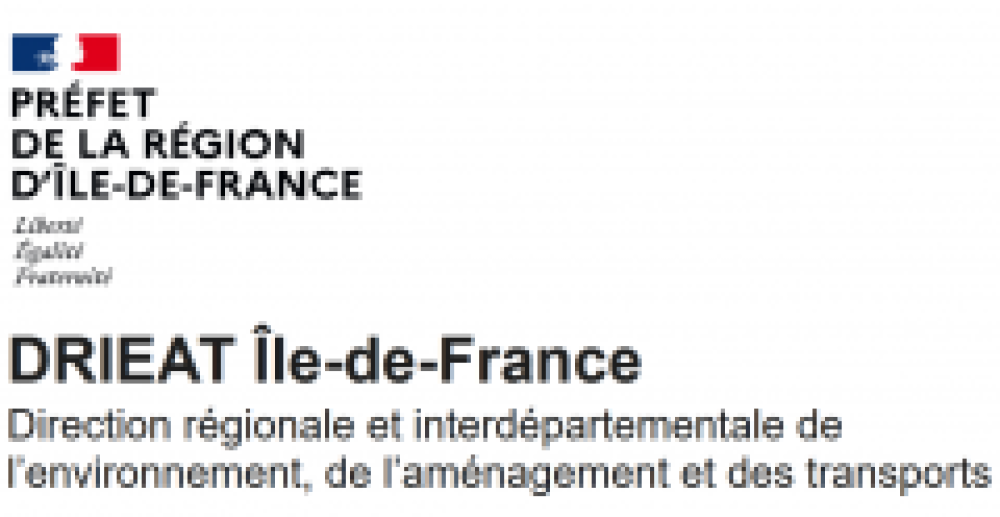
Mise en œuvre du plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Seine-Normandie
DRIEAT Île-de-FranceDate limite : 18/12/2025 (publiée le 18/11/2025)
Veille eau c'est aussi

LA LISTE DES ETABLISSEMENTS PROPOSANT DES STAGES
Consultez la liste de tous les établissements proposant des stages dans les métiers de l'eau, classés par département

Animateur(rice) du contrat Eau, Trame verte et bleue, Climat
Association EspacesDate limite : 17/12/2025 (publiée le 17/11/2025)

Observatoire piscicole et thermique des cours d’eau du département de l’Ain : mise en place d’une méthode et d’outils analytiques pour la valorisation des données acquises
FDAAPPMA 01Date limite : 19/12/2025 (publiée le 17/11/2025)

Responsable cellule travaux réseau de distribution d'eau potable (H/F)
Tours MétropoleDate limite : 16/12/2025 (publiée le 16/11/2025)

Stage continuité écologique, ICE (Indices sur la Continuité Ecologique) et l’évaluation des passes à poissons sur le Léguer
Guingamp Paimpol Armor Argoat AgglomérationDate limite : 10/12/2025 (publiée le 16/11/2025)

Stage étude du caractère envahissant de la laitue d’eau sur le contre canal du rhône (H/F)
FDAAPPMA 30Date limite : 09/01/2026 (publiée le 16/11/2025)

Les événements de sécheresse dans le bassin du Drac (19e-20e siècle) : Le cas des dossiers des Ponts et Chaussées
Université Grenoble AlpesDate limite : 16/12/2025 (publiée le 16/11/2025)

Chargé de mission suivi et gestion des ressources en eau (H/F)
EPTB Maralpin - Syndicat Mixte pour les Inondations, l'Aménagement et la Gestion de l'Eau (SMIAGE)Date limite : 18/12/2025 (publiée le 13/11/2025)

Chef(fe) de pôle contrôle en assainissement collectif et non collectif (H/F)
Annemasse AgglomérationDate limite : 13/12/2025 (publiée le 13/11/2025)

Conducteur de Station d'Epuration H/F
Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA)Date limite : 13/12/2025 (publiée le 13/11/2025)

Chargé(e) d’études et travaux H/F
Régie des Eaux DLVAggloDate limite : 13/12/2025 (publiée le 13/11/2025)

Responsable de la cellule études et travaux (H/F)
Régie des Eaux DLVAggloDate limite : 13/12/2025 (publiée le 13/11/2025)

Chef d’équipe technique gestion abonnés H/F
Régie des Eaux DLVAggloDate limite : 13/12/2025 (publiée le 13/11/2025)

Stage en projections hydrologiques sur le massif de la Vanoise à l’horizon 2100 avec le modèle J2000-Rhône-Glaciers
InraeDate limite : 08/12/2025 (publiée le 13/11/2025)
Veille eau c'est aussi

LA LISTE DES ETABLISSEMENTS PROPOSANT DES STAGES
Consultez la liste de tous les établissements proposant des stages dans les métiers de l'eau, classés par département

Chef de service eau et gestion hydraulique (H/F)
Voies Navigables de France (VNF)Date limite : 13/12/2025 (publiée le 13/11/2025)
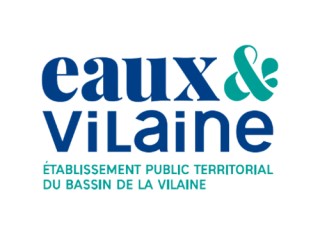
Stage suivi et compréhension des assecs sur l’illet, l’ille amont et la flume
EPTB VilaineDate limite : 13/12/2025 (publiée le 13/11/2025)

Etude avant travaux pour la restauration de plusieurs affluents dans les cévennes (H/F)
FDAAPPMA 30Date limite : 06/01/2026 (publiée le 13/11/2025)

Chargé(e) d’exploitation ressources en eau et barrages (F/H)
CU le Creusot-MontceauDate limite : 31/12/2025 (publiée le 12/11/2025)

Responsable du service Etudes et MOE Réseaux H/F
Nantes MétropoleDate limite : 10/12/2025 (publiée le 12/11/2025)

Mise en place d'un observatoire de l'hydrologie dans le Morvan
PNR MorvanDate limite : 09/12/2025 (publiée le 12/11/2025)

Suivi et analyse des pêches d'écrevisses de louisiane (programme life terra musiva)
Syndicat mixte des gorges du GardonDate limite : 07/12/2025 (publiée le 12/11/2025)

Chargé(e) d’étude télémétrie et suivis ichtyologiques
InraeDate limite : 11/12/2025 (publiée le 12/11/2025)

Responsable de secteur Conduite d'Usine assainissement (H/F)
SIAAPDate limite : 11/12/2025 (publiée le 11/11/2025)

Stagiaire Gestion quantitative de la ressource en eau sur le Marais poitevin (F/H)
Etablissement Public du Marais Poitevin (EPMP)Date limite : 02/01/2026 (publiée le 11/11/2025)

Réalisation d'un diagnostic hydromorphologique, hydraulique et écologique des cours d'eau
CC Mad et MoselleDate limite : 11/12/2025 (publiée le 11/11/2025)

Mise à jour de l’état des lieux du SAGE (H/F)
EPAGE Haut-Doubs Haute-LoueDate limite : 08/12/2025 (publiée le 05/11/2025)
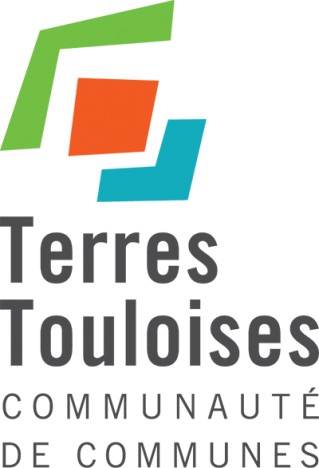
Diagnostic hydromorphologique des petits cours d'eau du territoire (H/F)
CC des Terres TouloisesDate limite : 31/12/2025 (publiée le 03/11/2025)

Inventaire participatif des mares sur le périmètre du contrat territorial Loire Lignon
EPAGE Loire LignonDate limite : 31/12/2025 (publiée le 28/10/2025)

Stage plan de gestion stratégique des milieux humides (H/F)
Syndicat Mixte du bassin versant de la LanterneDate limite : 15/12/2025 (publiée le 28/10/2025)
Veille eau c'est aussi

DES PUBLICATIONS
Plus de 2 100 publications classées par thématique

Etude pour la réalisation d'un pré-diagnostic sur les pollutions diffuses (H/F)
Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée de l’Arnon Aval (SMAVAA)Date limite : 11/12/2025 (publiée le 28/10/2025)

Stage en sensibilité d’un modèle hydrologique anthropisé à des scénarios de consommations en eau potable et de réutilisation des eaux usées
InraeDate limite : 14/12/2025 (publiée le 21/10/2025)

Mise en place d’un observatoire du drainage et proposition d’actions
EPTB CharenteDate limite : 07/12/2025 (publiée le 14/10/2025)

Ingénieur(e) d’étude Assainissement autonome durable et réutilisation de l’eau
InraeDate limite : 15/12/2025 (publiée le 13/10/2025)

Etat des lieux et caractérisation du potentiel de restauration des zones humides du bassin versant du Lot Aval
Syndicat Mixte pour l'Aménagement de la Vallée du Lot (SMAVLOT)Date limite : 13/02/2026 (publiée le 15/09/2025)
Ne ratez aucune nouvelle annonce : pour recevoir les nouvelles offres d'emplois et de stage tous les matins, inscrivez-vous à notre newsletter !
Toutes les offres d'emplois et de stages Emplois dans les métiers de l'eau Stages dans les métiers de l'eau Emplois technicien de rivière Emplois traitement des eaux Emplois zones humides Emplois hydraulique Emplois assainissement Emplois chargé d'études / chargé de mission Emplois hydrobiologiste





